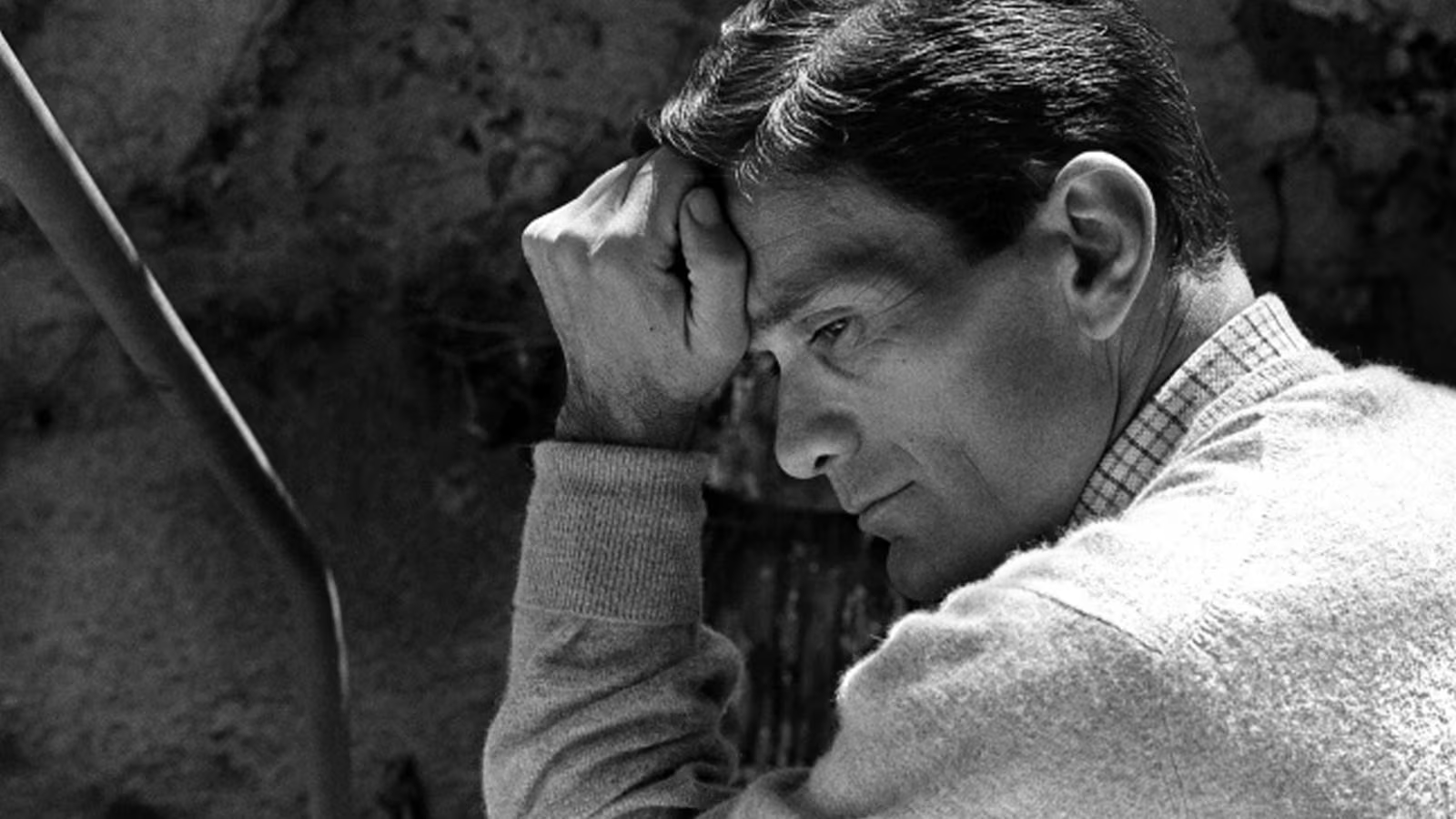« Yannick Haenel montre aux lassés des lettres du XXIe siècle ce que la matière textuelle peut encore faire d’inouï, pour et par les soleils noirs de nos vies. »
Lorsque l’écriture n’est plus affaire de divertissement privé, et qu’elle fait œuvre, forte d’efforts toujours renouvelés par celui qui, livre après livre, entre véritablement dans la cage aux lions nommée littérature, elle finit par tournoyer autour de pôles brulants où la langue, mise en satellite, tresse la partition intrigante de ce qu’elle convoite sans ne jamais parvenir à s’y assimiler. Or, elle n’a pas, en réalité, et ce malgré son zèle, à le faire : le cas échéant, le pôle s’évanouirait, et nous resterions en deuil de visions, abolies par la résolution du problème. Le travail acharné de Yannick Haenel est la figure même de ce phénomène merveilleux, au sens épouvantable et charmant du terme : l’aventure et l’aliénation, la mal et l’innocence, le désir pulsionnel et l’abattement sont pour lui d’authentiques idées fixes qui, à la manière de celle qui coûta la vie à l’égaré romantique de la Symphonie fantastique de Berlioz, poursuivent les narrateurs ou personnages illustres de ses romans, de ses essais, jusqu’à ce que folie et publication s’en suivent. La maîtrise de la plume est cependant la clef pour ne pas se bercer de l’illusion que la satiété est possible. À grand renfort d’extases greffés à la rigueur de celui qui sait que sans travail, l’on n’est rien, Yannick Haenel montre aux lassés des lettres du XXIe siècle ce que la matière textuelle peut encore faire d’inouï, pour et par les soleils noirs de nos vies.
Certaines entreprises littéraires sont à saluer pour la cohérence de leur économie : loin de sous-entendre qu’elles sont bien sages et attendues, nous voulons signifier par-là que dans chaque ramification qui les prolonge, une même intention met en branle texte et langue, pour tendre avec intensité égale vers un lieu d’interrogations autour duquel tournoie l’auteur – et le lecteur, avec lui. Tout en elles s’applique à convaincre celui à qui l’on s’adresse, d’embarquer à nos côtés et de poursuivre nos idées fixes : c’est très exactement ce à quoi se livre Yannick Haenel depuis qu’il publie. Nous venons d’évoquer ses centres gravitationnels, parce qu’obsessionnels – ou l’inverse – et qui, remarquons-le, n’ont pas pu ne pas être ceux de la grande majorité d’entre nous, à un moment ou un autre. Comment ne pas se sentir concerné par le servage que représente le capitalisme et le sacrifice, en son nom, de la fantaisie, de la joie de faire n’importe quoi et d’aller n’importe où ? Est-il un corps qui ait pu oublier l’éveil du désir, de ses modalités d’apparition troublantes et secrètes, énigme d’une vie ? Est-il une âme restée sans effroi devant le vice de l’homme dont l’horreur devient régulièrement le métronome ? Une âme restée sans émoi devant un être lumineux aux intermittences et évanouissements sans pourquoi, qui nous offre le miracle d’une beauté d’autant plus saisissante qu’elle nous fuit ? Pour ce qui regarde les quelques indifférents dont l’esprit n’a jamais été effleuré par aucun de ces labyrinthes, laissons-les errer sur le quai ; pour ce qui nous regarde, prenons le large auprès de Yannick Haenel.
Notre rétrospective n’a pas vocation à égrainer la bibliographie de l’auteur, mais bien davantage à exposer les points saillants de sa démarche artistique et existentielle. Puisque Wikipédia et ChatGPT nous épargnent la corvée des longues présentations convenues, sautons aussitôt au cœur du phénomène étrange et singulier « Yannick Haenel ». Nous retiendrons, d’une part, la cohérence littéraire de l’auteur, déjà mentionnée, et d’autre part la forme que celle-ci adopte pour constituer de façon plurielle, mais néanmoins fluviale, une quête vers « l’insaisissable », comme il le confie au micro de Radio France (2024). Cette volonté s’illustre par deux grands types d’écrits, qui, par beaucoup d’aspects, s’entrelacent, malgré la rupture qu’on leur prête : le roman et l’essai. Or, chez Yannick Haenel, il y a de l’essai dans le roman, et du roman dans l’essai : la théorie ne saurait se passer de fiction, et la fiction de réflexivité – et ce sans doute car l’imaginé et le pensé se hantent l’un l’autre. Cette gémellité – dont on pourrait remettre en cause les fondements, mais là n’est pas le sujet – s’assume de plus en plus depuis le XXe siècle, et culmine au XXIe. Homme de son temps, Haenel se prête au jeu de la mise en abyme de l’écrivain qui, au sein de son roman, intervient et se rappelle au lecteur en tant que moteur de la langue – et de l’essayiste, qui arrime à l’autobiographique la vie et l’œuvre d’artistes illustres dont il dresse le parcours et analyse le travail, dans une optique de singularisation de la réflexion. Afin d’approcher de plus près ce procédé hybride et sa réappropriation à nouveaux frais par notre auteur, pénétrons Cercle et La Solitude Caravage, deux écrits édifiants au double regard d’une trajectoire individuelle et collective en terres littéraires. À partir du substrat commun à toute son œuvre, la notion d’« aventure », remontons vers ce qu’elle implique d’inscription originale dans le champ de la littérature contemporaine.
L’aventure comme credo
L’aventure : le mot est revendiqué par Yannick Haenel depuis les débuts de sa carrière littéraire, jusqu’à la création toute récente de sa revue et collection chez Gallimard, « Aventures ». Cependant, il n’est pas lâché à la légère : dire « je pars à l’aventure » est lourd de conséquences. On l’affirme les lèvres retroussées juste assez pour voir briller les canines, et avec la voix légère de l’enfant innocent et vorace. On part avec l’appétit du naufrage, ou bien l’on ne part pas ; et, à la faveur de l’audace, on voit « quelquefois ce que l’homme a cru voir » (« Le Bateau ivre », Arthur Rimbaud). C’est ainsi que, sommairement, se présente l’entreprise de Yannick Haenel. Une aventure intégrale au cœur du vivant ; la possibilité, aujourd’hui encore – mais à quels coûts ? – de larguer les amarres vers un ailleurs aux contours d’autant plus obsessionnels qu’ils s’acharnent en vain à fixer de la brume.
Il en va effectivement et toujours dans ses écrits d’un appel du lointain – non seulement géographique, mais aussi spirituel, l’un ne va jamais sans l’autre – sans justification, inouï, et, puisqu’inouï et injustifié, impératif. Parce qu’il n’y a pas de cause, parce que le lien avec le quotidien rompt et le réel corseté s’effondre, il faut s’engouffrer dans la brèche, aller là où l’on n’est pas. Cette expression est la grammaire du complexe narratif de ses récits et de ses essais : aller là où je ne suis pas, pour braver les sables mouvants d’une société aux airs de chambre mortuaire, pour s’extraire du raz de marée de visages en deuil d’eux-mêmes et calcinés par l’ennui. Aller là où personne n’a posé le pied, étendre le planisphère du réel en recréant celui de la langue : voilà le pari fou de notre auteur, et par procuration, de Jean Deichel, narrateur de Cercle, qui, le 17 avril à 8h07, se trouve soumis à l’injonction soudaine de ne pas prendre le train pour se rendre à son travail, et de « reprendre vie » (p. 15). En d’autres termes, d’errer et d’aller là où on l’appelle, ce « on » n’étant rien d’autre que de vagues échos qui lui parviennent de loin, sans paroles : l’intuition du lieu, du moment, de ce qu’il faut faire pour recouvrer le goût de l’existence, dissimulé derrière celui du quotidien morne à qui l’on aliène notre temps, notre énergie, nos possibilités de vivre – derrière les simulacres du capitalisme, où s’éteignent les corps en jachère de secousses. De Paris à Prague, en passant par Berlin et Varsovie, le déserteur écrit compulsivement les mots, morceaux de phrases que lui inspirent rencontres, expériences, paradisiaques ou infernales (notons que la structure du roman reprendre celle de La Divine Comédie de Dante, qu’il s’agisse du parcours initiatique de Jean Deichel ou des trois « Cercles » structurant le livre). Le voyage est également une composante majeure de La Solitude Caravage : évoquant sa scolarité au Prytanée de La Flèche, où il rencontre la pulsion érotique primitive en contemplant Judith et Holopherne du Caravage dans un livre d’art, Yannick Haenel relate les pérégrinations qui suivirent, au cours desquelles il croisa le chemin du peintre de façon toujours plus singulière, jusqu’à ce qu’il parvienne à dire ce qui touche au plus près de sa peinture et de sa charge existentielle.
L’aventure, au sens étymologique du terme – avant même de reprendre sa définition médiévale, à laquelle se réfère Yannick Haenel (Zone Critique, 2025) – est substantiellement ce en quoi consiste son écriture et la trajectoire des narrateurs, qu’il s’agisse de lui ou de ses persona tels que Jean Deichiel : l’imminence de ce qui est à-venir (advenire), et le consentement à ce que cela suppose. On ne planifie rien, on s’en va, les poings dans les poches crevées, et, avec une obstination autistique, on s’en remet à la bonne fortune, car on ne peut plus faire autrement que de laisser arriver ce qui arrive, voire d’aller à la rencontre de ce qui doit arriver. À ce très littéral retour aux sources linguistiques s’ajoute l’aspect revendiqué explicitement par l’auteur : l’aventure, dans la littérature médiévale, désigne plus qu’un simple récit de voyage. Il s’agit d’un terme étroitement lié à la chevalerie, et donc à la mise en danger, à l’initiation physique et spirituelle au monde. Yannick Haenel évoque les « étranges aventures » dont parle Chrétien de Troyes à propos du chevalier Yvain : et, pour sûr, les aventures contemporaines de Jean Deichiel et de tous ses autres sont bien étranges. Ce sont des rencontres avec des individus loufoques, avec des livres, des peintures, ce sont des expériences érotiques initiées par la connivence des corps de chair et des corps de lettres ou de pigments, ce sont des égarements dans une synesthésie quasi pathologique… L’étrange se manifeste chez Yannick Haenel sous la forme d’une fissure dans le quotidien, éventré par ce qu’il nomme l’« existence réelle ». La brèche laissée par cette intrusion devient un interstice où plus rien n’est, sinon l’aperception de tout, sous la forme d’un carnaval d’impressions inqualifiables. Prendre le parti de l’aventure, c’est prendre le parti de provoquer l’avènement de cette lisière, de demeurer au seuil de la vie vraie – flux incompréhensible qu’il faut se contenter de supporter, en cela qu’il délie nos convictions et notre rapport rationnel et entendu au monde. C’est, très souvent, par la médiation de l’art qu’une faille entaille la vie fausse : un individu, frappé par des détails, mots où coups de pinceau, ouvre la porte de ce qu’il y a sous les impressions de surface. À grand renfort de pirouettes descriptives où le surréalisme – sous-réalisme, en vérité, puisque les mots ne volent pas au-dessus du réel, mais le forent – entre par effraction dans la narration, Yannick Haenel s’efforce de rendre compte de ce monde de derrière, de ce lieu qui se dérobe sous nos pieds et nous laisse suspendu au-dessus, en-dessous, à droite et à gauche de ce que personne ne prend le risque de voir : le monde sans lois ni manières.
Cependant, une telle expérience n’est pas sans danger : si les lois culturelles disparaissent, celles de la nature et de la matière également. Ainsi, à trop approcher la vie, on risque fort de s’y laisser détruire : elle est à l’homme ce que le soleil est à la Terre : le centre de tout, qui peut nous réduire à rien. Écrire, dès lors, relève en soi de l’aventure : le crayon trace les contours de ce qui menace d’engloutir la main qui le tient, et, avec elle, les fruits de son labeur. Si la béance est l’endroit d’où tout est visible, la pénétrer condamne au naufrage sans retour, au mutisme scriptural : à la dissolution de l’homme et de l’œuvre. Voir, voir, voir : mais ne pas sombrer. Valser avec le gouffre sans succomber à la pesanteur qui nous invite à y plonger. L’aventure, c’est aller vers, mais vers un lieu qui suppose tout sauf la ligne droite.
De la nécessité des pas de côté
Maintenant que nous sommes davantage renseignés sur l’astre autour duquel tourne l’entreprise littéraire de Yannick Haenel, se pose la question de comprendre plus avant les modalités par lesquelles l’écriture s’y grève, et devient révolution : destruction d’un ordre établi, retour à la table rase, et, depuis les ruines, édification d’un nouvel ordre. Par « ordre, » en littérature, nous entendrons tout simplement « la langue », et son comportement. Comment doit-elle saper le langage vulgaire pour s’incorporer l’aventure ? Que lui coûte l’expérience intégrale de l’« existence réelle » ? Quel est son devenir, dans l’économie globale d’une œuvre dont la débâcle heureuse de l’être-au-monde constitue le point nodal ?
Contrairement à ce que laisse suggérer l’ampleur vertigineuse du projet, les moyens employés par Yannick Haenel afin de lui faire prendre corps ne donnent pas dans le spectaculaire, ni dans l’extravagant. Moderniser une quête existentielle, bouleverser les codes qui la pétrifiaient ne suppose pas tant pour lui de violenter la syntaxe, que de faire du roman classique le lieu de jeux polyphoniques, où ce sont les registres, les atmosphères, aussi épurés soient-ils, qui agissent et transforment l’action du langage sur notre perception du quotidien – qui s’efforce de ne plus en être un. C’est d’ailleurs à cet endroit que point un aspect saillant du style de l’auteur : sa dimension plurielle lui permet de brouiller les frontières (sans les abolir tout à fait, auquel cas les textes perdraient en précision et en virtuosité) ; jonglant entre des moments extrêmement réflexifs, narratifs et descriptifs, ses œuvres donnent autant à rêver qu’à penser, au prisme de ce qu’elles évoquent d’éminemment graphique et pictural, d’abstrait et conceptuel. Ce floutage est étroitement lié à la forme : les essais sont romanesques, les romans réflexifs – de façon explicite – et chacun, conservant leurs caractéristiques classiques, n’en demeure pas moins gros d’excroissances et d’effractions génériques. Cercle est ainsi la mise en scène d’un écrivain que l’on peut volontiers considérer comme un double fictif et radical de Yannick Haenel : si trame narrative il y a, elle s’exhibe sans détour sous la forme d’une tresse compliquée, genre coiffé-décoiffé, où la pensée emmêle et démêle les errances de Jean Deichiel, narrateur dont le travail d’écriture se déroule dans la même temporalité que celle du lecteur. En d’autres termes, et parce que la structure du roman le permet, nous sommes plus que dans la simple fabrique du créateur : nous sommes la fabrique, son mouvement : nous écrivons en lisant.
Par ce tour de force, Yannick Haenel va peut-être encore plus loin que ce qui, depuis plusieurs années, se fait dans l’hybridation réflexivité/narration, et radicalise une tendance déjà bien radicale. Nous pensons notamment à Pierre Michon, qui, dans Les Onze, immerge son lecteur dans l’atelier d’un peintre, en l’apostrophant sous la forme d’un bonimenteur feignant le guide de musée : nous sommes donc bien embarqués dans un complexe narratif mettant en abyme au sein du livre l’avènement de ce qu’il est, à savoir la représentation scripturale d’une représentation plastique – un tableau ayant pour motif la période historique de la Terreur. Or, si la narration mime le mouvement de l’art et de l’histoire se faisant, elle se refuse à franchir le pas supplémentaire qui consisterait à dévoiler les rouages de son propre dispositif discursif : pour le dire autrement, elle avance encore masquée. Dans Cercle, comme dans La Solitude Caravage, le masque tombe. On pourrait penser que trop de ficelles apparentes tuent la ficelle : mais, a contrario, l’abondance de dévoilements est justement l’outil permettant de voiler et de plonger dans l’embarras ce qui, d’apparence, pouvait sembler le dissiper. En outre, la multiplication des fils, loin de confiner à une intrication narrative trop embrouillée pour permettre au lecteur de cheminer avec aisance dans le texte, œuvre à éclairer, par la manière dont ils se nouent, la difficulté d’être dansle monde, davantage que celle de le comprendre – puisque c’est précisément ce que la littérature de Yannick Haenel se refuse de faire.
On pourrait également amalgamer son travail avec l’autofiction et la littérature de témoignage : genres vagues où l’on classe volontiers toutes les œuvres qui, de près ou de loin, mêlent au narratif des éléments appartenant en propre à la vie de l’auteur. Mais, là aussi, il faut être prudent : cet autre type de mise en abyme – de soi, en l’occurrence – dans le récit est également pluriel et sujet à maintes variations non négligeables permettant d’extraire, parmi la masse, les œuvres qui font véritablement preuve d’ingéniosité. Annie Ernaux, avec l’auto-sociobiographie, Bertrand Belin, avec le conte autobiographique, en sont des exemples : ils ne se contentent pas de mélanger fiction et réalité pour mieux se raconter, ils se racontent dans la fiction pour s’excéder et donner à voir plus qu’eux-mêmes – en bref, non pas pour raconter leur monde, mais le monde sous un jour paradoxalement anonymisé. La Solitude Caravage figure parmi ces décentrements génériques. Si tout part d’un événement autobiographique, à savoir la castration de l’identité par un séjour au Prytanée militaire de La Flèche et l’obsession soudaine pour un tableau du Caravage, Judith et Holopherne, la première personne qui « parle » tout au long de l’essai ne restitue pas tant une expérience personnelle, un itinéraire ancré et clos sur lui-même, qu’une épopée au cœur de la vie du peintre, où l’essayiste disparaît derrière ce qu’il raconte. Son périple devient celui de la peinture elle-même : ce qu’elle peut, ce qu’elle fait, et ce vers quoi elle nous transporte, indépendamment de qui nous sommes.
Tout l’enjeu du travail littéraire de Yannick Haenel a ainsi consisté à se réapproprier – comme Pierre Michon, Annie Ernaux, ou encore Bertrand Belin l’ont fait – le « récit réflexif » qui représente – si l’on grossit le trait – la tendance principale de la littérature narrative française actuelle. Pour faire œuvre, il faut savoir reconnaître ce qui constitue l’époque, et effectuer simultanément le pas de côté qui singularise. Yannick Haenel circonscrit ainsi à dessein la forme et les objets de ses textes, pour se particulariser et faire jaillir, depuis un lieu inexploré, une expérience inaugurale de l’altérité et du monde, dans ce qu’il peut avoir de plus primitif et charnel. Bref : une cabriole, et c’est la révolution. La langue s’accroit de l’usage que l’auteur en fait, et ses livres s’inscrivent dans le catalogue de celle-ci pour la remanier entièrement. En sapant ses assises, et celle de la littérature, Yannick Haenel insuffle dans l’air du temps un vent de défi provoquant, adressé à tous. « Les corps humains sont des agneaux déjà sacrifiés, et leur existence est un long bûcher » (La Solitude Caravage) : pour échapper au sort des corps ordinaires, il nous invite dans chacun de ses livres à laisser derrière nous l’aboulie et les mondanités ; à lever l’ancre et dévier vers le rivage des incertitudes, de la folie, du festin des débâcles où éclot la vie authentique.