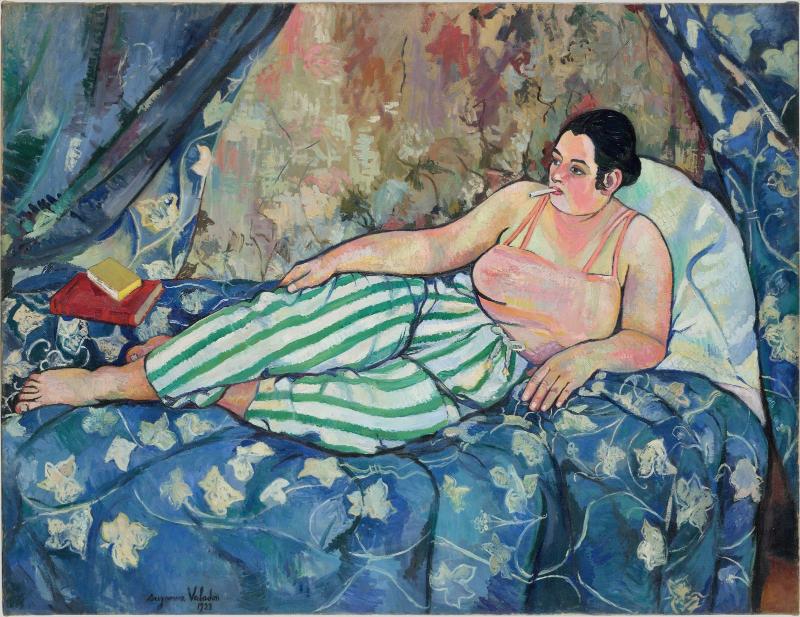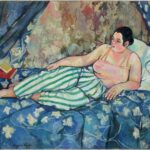Vingt ans après avoir surpris les cercles de gauche radicale par sa prise de position sur l’idée d’une Constitution européenne, le philosophe révolutionnaire italien Toni Negri — qui voyait dans ce projet, aussi imparfait fût-il, un terrain de lutte contre l’hégémonisme de l’Empire (Empire, Hardt et Negri, Exils, 2000) et une occasion de « faire disparaître cette merde d’État-nation » — mérite d’être relu à l’aune des débats contemporains. Revenons brièvement sur sa conception de l’Europe et son évolution, des débats de 2005 à son discours de 2018 à l’ENS : un projet à réinventer, au-delà des impasses du repli souverainiste comme des logiques néolibérales, qu’il appelait à dépasser par une nouvelle grammaire politique.
En marge de ses travaux sur Spinoza et Hegel, de l’élaboration de son concept de « multitude » et de la conceptualisation d’un salaire minimum mondial, ou encore de sa critique de « l’Empire », Toni Negri, philosophe emblématique de l’opéraïsme, s’est également intéressé à la question de l’Europe. Loin de s’en tenir à une critique classique de l’Union européenne, sa pensée vise à déconstruire le projet libéral européen tel qu’il s’est institué à partir des années 1980, tout en affirmant la nécessité stratégique d’un horizon politique européen alternatif, fondé sur l’autonomie des luttes, la démocratie radicale et la constitution du commun. Sa prise de position en faveur d’un « oui » lucide et critique lors du référendum sur le TCE avait particulièrement surpris les cercles de la gauche radicale. Elle est pourtant profondément cohérente avec la pensée du philosophe, fondamentalement opposé au principe d’État-nation et critique des replis souverainistes.
L’État-nation : une impasse politique
Une partie de la pensée de Toni Negri insiste sur la dimension obsolète de l’État-nation, forme née du système westphalien et renforcée par les souverainetés industrielles, devenue un véritable obstacle à la libération des forces sociales. C’est précisément cette position qui le poussera, en 2005, au moment des débats sur le référendum sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE), a exprimé dans un entretien pour Libération avec un brin de provocation son espoir de « faire disparaître cette merde d’État-nation » au profit d’une Europe post-souverainiste capable d’organiser autrement les rapports sociaux et politiques. Au-delà de son « oui » critique au TCE, il ne faudrait en aucun cas interpréter cela à l’aune d’une naïveté européisme. Negri n’y voit qu’une brèche, qui ouvrirait peut-être la voie à fédéralisation accrue, unique horizon envisageable pour une démocratie post-nationale. Et c’est en cela que réside l’opposition radicale de Negri avec les souverainistes, de droite comme de gauche radicale. Pour le philosophe italien, l’ennemi n’est nullement incarné par l’Europe comme espace, mais bel et bien par l’Europe en tant qu’elle reproduit les logiques étatiques et libérales qu’elle prétend dépasser.
Une critique radicale du projet européen néolibéral
Ainsi Toni Negri s’est-il montré particulièrement critique et virulent à l’égard du fonctionnement de l’Union Européenne. En témoigne une conférence prononcée à l’École normale supérieure d’Ulm le 5 mars 2018, publiée par la suite comme chapitre de l’ouvrage collectif Une certaine idée de l’Europe (Champs-Flammarion, 2019), sous le titre de « L’Europe que nous voulons ». Le philosophe y dresse le constat de l’échec du projet européen tel qui s’est établi, c’est-à-dire sur une fondation ordo-libérale au service de la circulation du capital et au mépris des aspirations démocratiques des peuples.
L’impossibilité du « dehors » et la nécessité d’un « dedans contre »
L’une des thèses primordiales de Negri consiste à affirmer qu’il n’existe aucun « dehors » à l’Europe : ni les États membres ni leurs peuples ne peuvent se soustraire à la logique de la mondialisation capitaliste de la gouvernance continentale. En souhaitant quitter l’Europe, les souverainistes se fourvoient et négligent l’État du monde. Pour le philosophe italien, la seule option réaliste demeure les forces contestataires serai de lutter depuis l’intérieur de l’Union, non pas pour l’adapter à la marge, mais en vue de la défaire et la refonder. Ce faisant Negri rejette deux illusions : celle d’une nativité sociale-démocrate persuadée de pouvoir réformer l’Union par le haut, et celle d’une reconquête souverainiste comme base de renaissance populaire. Il cherche à transcender cela en appeler à une rupture franche avec ce qu’il tient pour certains des grands piliers de l’ordre néolibéral : la souveraineté étatique et la propriété privée. Dans sa perspective, l’abolition de la frontière nationale et de l’économie de marché conduirait à l’émergence d’une nouvelle dynamique institutionnelle, tournée vers les besoins sociaux, la liberté de circulation et l’émancipation collective.
Le commun comme projet européen
C’est dans cette perspective que Negri conceptualise une alternative : l’établissement d’une Europe du commun. Nulle question d’une utopie abstraite mais, au contraire, d’un projet politique enraciné dans les luttes contemporaines : antifascisme, anticapitalisme, mobilisations féministes, défense des migrants, expérimentations municipales, initiatives coopératives, résistances écologiques… Ces luttes, souvent fragmentaires, constituent autant de puissances constituantes qui, selon Negri, préfigurent une nouvelle forme d’institutionnalité, déliée des États-nations et des logiques de marché. Pour le philosophe italien, cette démocratie du commun s’incarne dans les « villes rebelles » comme Barcelone ou Naples, qui sont à ses yeux des exemples concrets où les initiatives se construisent par le bas, à partir des besoins, des solidarités et des désirs populaires.
Il prône un réseau transnational qui constituerait une base matérielle en vue d’une nouvelle citoyenneté européenne, non pas fondée sur l’appartenance nationale mais sur la participation active dans les combats sociaux. À ses yeux, l’Europe ne peut se réinventer que si elle parvient à devenir le catalyseur d’un nouveau projet d’émancipation collective.
L’Europe comme champ de bataille constituant
Finalement, la pensée européenne de Toni Negri se révèle moins paradoxale qu’a pu le laisser entendre son adhésion critique au TCE. Elle est traversée par une tension féconde entre critique radicale et perspective stratégique, qui se révèle cohérente avec son projet intellectuel global. Elle refuse à la fois l’abandon du projet européen aux forces du marché et le retour illusoire à une souveraineté nationale perçue comme protectrice. Le philosophe italien invite au contraire à penser différemment l’Europe, en dehors des nations et au service d’un commun à élaborer, qui verra le triomphe des forces constituantes (les multitudes en lutte) face aux pouvoirs constituées (l’Union sous sa forme libérale et capitaliste et les États-nations autoritaires).
Contrairement à une gauche radicale trop souvent eurosceptique et prête à se fourvoyer dans les replis nationalistes, Toni Negri comprend l’importance du collectif et de se défaire du carcan capitaliste de l’Union. À une époque où l’Union Européenne semble vaciller sous les coups des replis identitaires et des crises sociales, il rappelle qu’elle ne peut être sauvée qu’en étant refaite et refondée, jamais en étant défaite ou annihilée.