Il débarque en costume lamé, santiags aux pieds, avec une crinière de rockstar qui lui mange les épaules et des chansons comme des météores tombés d’un autre temps. À 31 ans, Lucio Corsi n’est plus tout à fait un ovni – il en a trop dit, trop chanté, trop flambé – mais il reste un mystère. Une révélation à rebours, à l’heure où la pop italienne carbure à l’électro propre sur elle et aux boys‑next‑door sans panache. Lui ? Il parle aux animaux, traîne avec des sorcières, cite David Bowie et Lucio Battisti dans la même phrase sans frémir. Et ça marche.
Sa percée ? Celle du grand public, entamée à Sanremo 2025 où Volevo essere un duro le propulse immédiatement sous les projecteurs : deuxième place au festival, disque de platine et Prix de la Critique Mia Martini. Puis, la consécration sur la scène européenne : l’Eurovision à Bâle, où son interprétation épurée – piano, guitare et harmonica joué en live sur scène, une première depuis 1998 – a électrisé l’auditoire et lui a valu une cinquième place.
Né à Grosseto, élevé entre les pins de la Maremme et les disques vinyles de ses parents, Corsi se fabrique très tôt un monde parallèle. Un monde de westerns baroques, de rock glam, de créatures fantastiques et de poésie rurale. Sa voix traîne un accent toscan délicieux, qui mord sur les voyelles et caresse les consonnes. Ses textes, eux, sont des fables hallucinées où l’on croise des renards qui philosophent, des avions tombés du ciel et des amours qui ne veulent pas mourir.
Mais ne vous y trompez pas : derrière le look de dandy cosmique et les poses androgynes, Lucio Corsi est un artisan. Il polit ses morceaux comme on taille une pierre rare, entoure chaque disque d’un univers visuel léché, entre peinture naïve et stylisme rétrofuturiste. Son dernier album, La gente che sogna, est une ode aux doux rêveurs, aux excentriques, aux marginaux magnifiques – ceux qui, comme lui, tiennent debout en défiant la gravité.
Un détail dit tout : sous sa chaussure, au feutre noir, on lit Andy. Comme Woody dans Toy Story, Corsi n’a jamais vraiment quitté l’enfance. Il appartient à ceux qui rêvent, qui s’inventent, qui refusent de grandir pour de bon.
Sur scène, il électrise. Telle une bête de foire sortie d’un conte punk, il bondit, éructe, séduit. Le public italien, longtemps frileux à ces météores trop brillants, semble enfin prêt à le suivre. Lucio Corsi ne veut pas plaire à tout le monde. Il veut raconter ses histoires, avec la voix de ceux qu’on n’écoute jamais. Et c’est pour ça qu’on l’écoute, enfin.

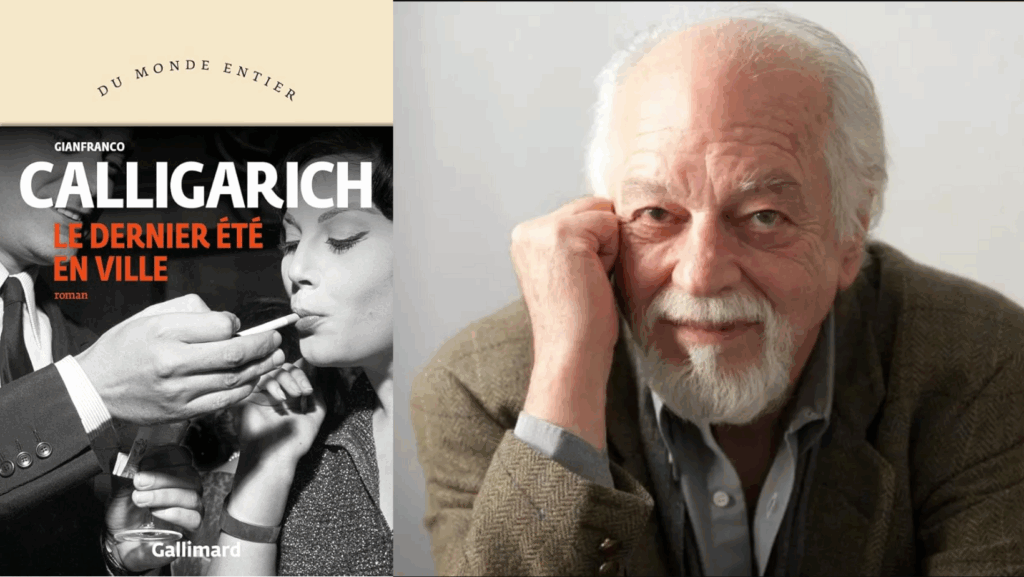








Vu à la télé à l’eurovision, un OVNI total. Merci pour l’article, ça lui rend bien justice !
Je viens d’écouter, il vraiment un truc unique ce gars qq part entre Bowie et un berger toscan lol, cest pas mal du tt
petit article très sympa en mode portrait libé, ça rigole plus!